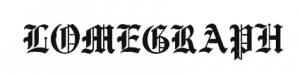Ce qui devait être un repas convivial s’est transformé en cauchemar collectif. Dans la petite localité de Kpétsou, deux personnes ont perdu la vie et plusieurs autres se battent encore pour survivre, après avoir consommé un bouillon de sang de bœuf lourdement contaminé. L’alerte a été donnée par l’Institut National d’Hygiène (INH), dont le rapport officiel lève le voile sur les origines microbiennes de ce drame sanitaire.
Un plat traditionnel devenu poison mortel à Kpetsou
Le bouillon de sang de bœuf, prisé pour sa saveur et sa richesse en protéines, est un mets emblématique des marchés du Bas-Mono. Ce soir-là, au marché de Kpalogo, il a pourtant véhiculé un cocktail toxique de bactéries. Les analyses menées par l’INH, sous la supervision de sa directrice, Dr Wemboo Afiwa Halatoko, pointent une contamination massive.
 Lire aussi: Intoxication alimentaire à Kpetsou : le « Houmbli » en cause
Lire aussi: Intoxication alimentaire à Kpetsou : le « Houmbli » en cause
Les résultats de laboratoire sont sans appel : Escherichia coli, Bacillus spp. et Clostridium spp. se sont invités dans les assiettes, déclenchant en quelques heures diarrhées sanglantes, vomissements, douleurs abdominales insupportables et fièvre intense.
L’hygiène au banc des accusés
Les enquêteurs de l’INH ont mené des prélèvements sur trois fronts à savoir: l’aliment incriminé, les selles des patients hospitalisés, l’eau de puits utilisée dans un ménage de Kpétsou. Le verdict est inquiétant. Il s’agit d’une contamination polybactérienne liée à des pratiques d’hygiène déficientes. « Il s’agit probablement de mécanismes mixtes, sécrétoires et invasifs, responsables des troubles digestifs observés », précise Dr Halatoko.
Cette découverte met en lumière un problème récurrent dans de nombreuses zones rurales: l’absence de contrôle sanitaire rigoureux sur les denrées vendues dans les marchés.
Des investigations encore en cours
Si la piste microbienne est désormais confirmée, l’INH reste prudent. Des analyses toxicologiques complémentaires sont en cours à l’Université de Lomé afin d’exclure toute intoxication chimique concomitante.
En parallèle, une étude métagénomique approfondie est menée pour identifier avec précision toutes les souches bactériennes responsables. Ces travaux pourraient orienter de nouvelles stratégies de prévention, afin d’éviter que le drame de Kpétsou ne se reproduise.
Au-delà de la tragédie humaine, cette affaire soulève une question brûlante : que mangeons-nous vraiment ? Dans un contexte, l’affaire de Kpétsou agit comme un électrochoc.
Des mesures fermes doivent être prises: contrôles renforcés, sensibilisation des vendeurs aux règles d’hygiène, et sanctions pour les contrevenants. Car derrière chaque plat traditionnel se cache une responsabilité collective : préserver la santé publique.
À Kpétsou, le goût d’un plat traditionnel s’est teinté de l’amertume de la perte et de la peur. Reste à espérer que cette tragédie serve de leçon et que plus jamais un repas partagé ne devienne un acte fatal.